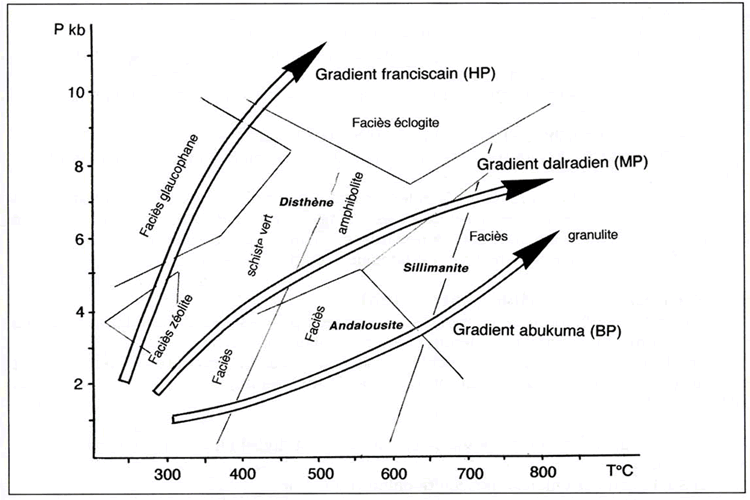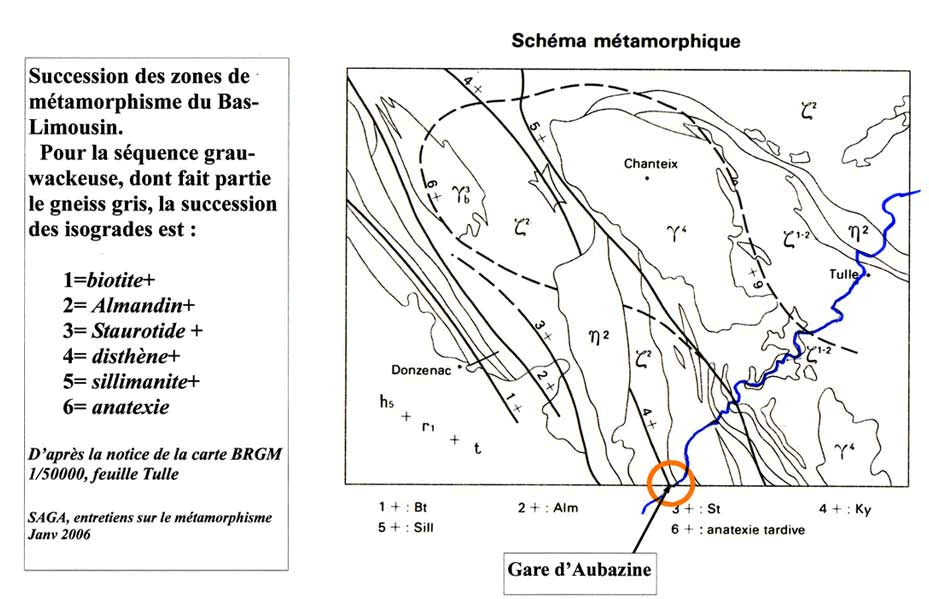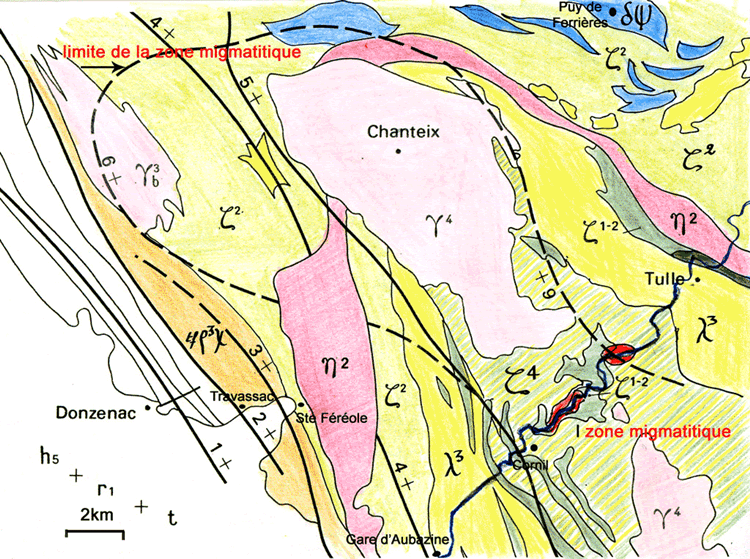La région du Sud-Limousin, ou Bas-Limousin, est souvent citée comme cas d’école pour illustrer le métamorphisme régional, et plus précisément le métamorphisme de gradient standard, dit « dalradien » : voir Figure 1. Ce septième entretien a pour objet de présenter les éléments de base et les indications concrètes pour la préparation d’une visite sur le terrain. Cette visite peut être conçue comme une initiation à la pétrographie, et à la tectonique, appliquées au métamorphisme. Dans beaucoup de cas, elle tire parti des beaux affleurements qui apparaissent sur une quinzaine de kilomètres le long de la N89, en suivant le cours de la Corrèze de Brive à Tulle.
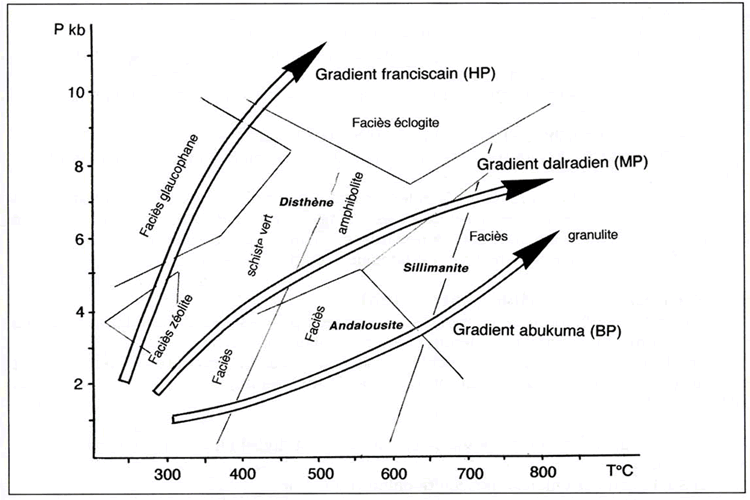
Figure 1 : le gradient dalradien est aussi dénommé gradient « barrowien », ou encore gradient de moyenne pression, à disthène-sillimanite. Le graphique, établi d’après Miyashiro, est tiré de l’ouvrage « minéraux et roches métamorphiques », de J.Cl.Pons (CRDP de l’académie de Grenoble, 2001).
En balayant du regard la carte géologique du BRGM d’Ouest en Est ( feuille de Tulle), à partir de l’extrémité du bassin de grès du Permien de Brive, il apparaît une succession de zones à métamorphisme croissant, depuis les schistes et quartzites de métamorphisme faible, jusque aux gneiss à Disthène et Sillimanite. D’autre part, nous avons déjà décrit l’apparition des migmatites (sixième entretien) au cœur de l’anticlinal. Le « gradient » se matérialise sur la Figure 2 par les isogrades des minéraux index classiques.
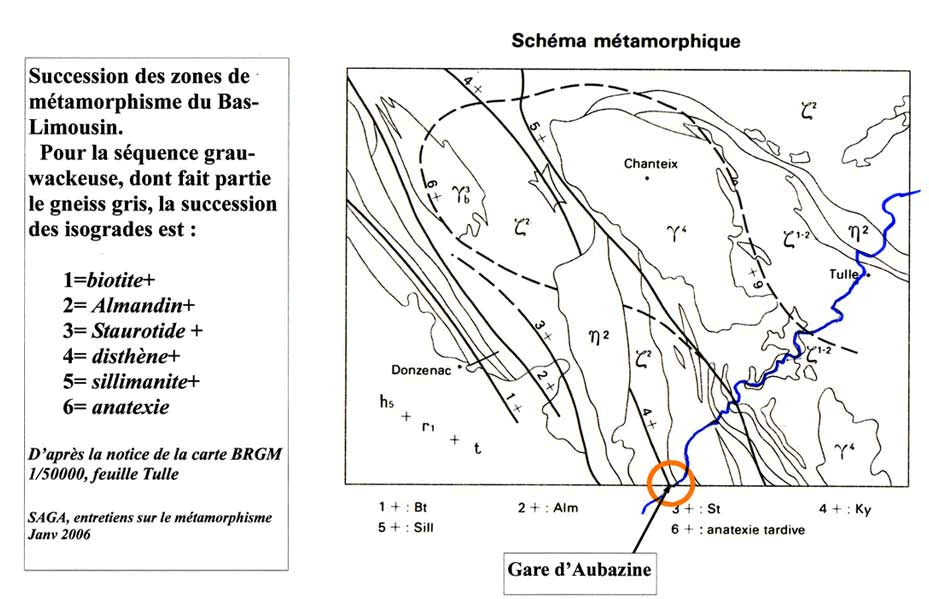
Figure 2 : carte géologique simplifiée du Sud-Limousin, tirée de la notice de la carte BRGM au 1/50 000, feuille Tulle, faisant apparaître les isogrades du métamorphisme régional.
Les conditions sembleraient donc réunies pour appliquer le schéma du gradient dalradien.
Cependant, l’examen plus détaillé de la carte de la figure 3 ci-dessous et les observations sur le terrain montrent une situation bien plus complexe. Nous allons le constater en suivant un axe SO-NE, défini par la vallée de la Corrèze depuis Malemort, à la sortie Est de Brive, jusque et au-delà de Tulle. Les terrains métamorphiques apparaissent sous la forme de bandes parallèles, allongées suivant l’axe NO-SE, et ceci jusqu’à l’axe médian de l’anticlinal de Tulle, puis à peu près symétriquement au-delà. Ces bandes ont été codées par les auteurs de la carte à l’aide des lettres grecques suivantes :
ρχ, ζ et λ, pour les terrains métamorphiques…
Ce sera l’objet du §3 de cet entretien de comprendre la raison de ces distinctions.
Quatre éléments vont jouer un rôle déterminant dans les observations. Ce sont:
| |
les discontinuités, |
| |
les corps basiques et leur énigme ! |
| |
la migmatisation, |
| |
les intrusions, |
Que nous allons maintenant détailler.
- De nombreuses discontinuités affectent l’observation des paragenèses et des minéraux index, du fait que entre plusieurs zones métamorphiques (les bandes parallèles citées plus haut), les roches d’origine peuvent varier et même différer complètement ; en d’autres termes, on observe une succession de roches métamorphiques paradérivées et orthodérivées (les termes sont expliqués §3.2). On va donc être amené à approfondir la notion de roche d’origine, à partir de la texture de la roche métamorphique, qui peut avoir retenu des témoins des origines, et aussi à partir de son chimisme.
- De nombreux petits corps de formations métamorphiques basiques sont présents. Les plus importants, du point de vue de la signification géodynamique, sont les éclogites dy à l’Est de Tulle(voir le cinquième entretien), et les amphibolites au centre et à l’Est de l’anticlinal. Il s’agit là d’une véritable énigme : comment des assemblages appartenant au faciès des éclogites, peuvent-ils se retrouver au sein de métapélites du faciès amphibolites ? la réponse sera apportée au §5, par le modèle géodynamique de la grande collision à l’origine de la formation de la chaîne hercynienne.
- Une vaste zone de migmatisation recoupe les zones du gradient métamorphique
- Enfin, l’ensemble de l’anticlinal de Tulle est recoupé par des massifs intrusifs de
granitoïdes, dont l’un, g4 au centre de l’anticlinal, est manifestement lié à la migmatisation déjà citée. Ces massifs sont organisés en bandes parallèles intercalées dans les zones métamorphiques, et disposées symétriquement par rapport à l’axe de l’anticlinal : voir figure 3.
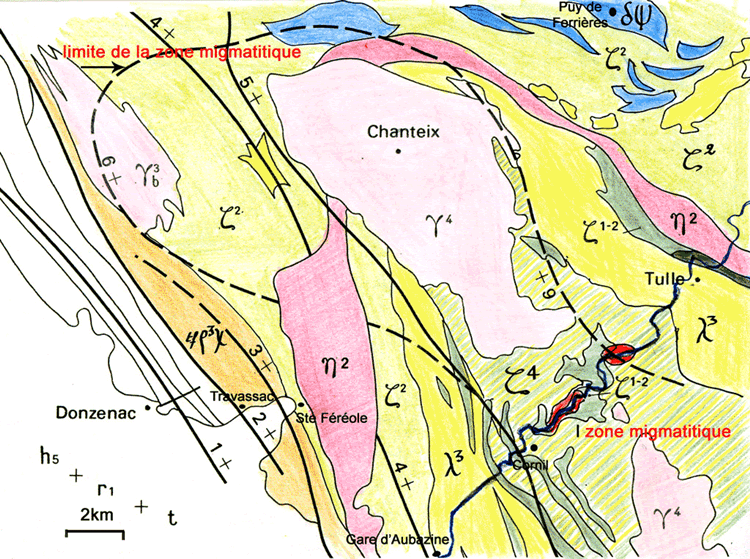
figure 3 : carte géologique simplifiée en couleur du Sud-Limousin, d’après la notice de la carte BRGM au 1/50 000, feuille Tulle. L’utilisation de la couleur permet de mieux visualiser la succession d’Ouest en Est des terrains métamorphiques et des intrusions décrites au paragraphe 3.2.
Ayant en mémoire ces quatre éléments, et en procédant à l’analyse pétrographique détaillée sur le terrain (§3), il sera possible d’extraire de cette apparente complexité l’histoire métamorphique et magmatique de la région. Toutefois, cela nécessitera de recourir aux résultats des techniques radioactives de datation (§ 4), qui éclaireront la succession des évènements dans un cadre interprétatif géodynamique (§5). |