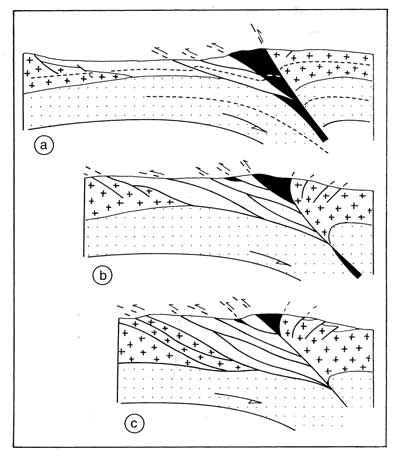Jusqu’aux années 70, l’interprétation qui prévalait pour la série du Bas-Limousin, était celle d’un gradient « dalradien » prograde, aboutissant à la transition ultime disthène-sillimanite, puis à la migmatisation. Mais elle se révèle trop simple pour expliquer l’association spatiale intime, à l’Est de Tulle, d’unités rétrogrades, de haute pression, à faciès d’éclogites, avec des unités dalradiennes progrades. Ces dernières ont manifestement été recristallisées, dans des
conditions dynamiques de grandes déformations. Or cette association est reproduite à grande échelle, sur la bordure ouest du massif armoricain et du massif central, suggérant un lien avec les phénomènes de collision et de subduction responsables de l’orogenèse hercynienne.
Comment est-on passé d’un gradient « franciscain », de haute pression, à un gradient « dalradien », de moyennes pressions/hautes températures ?
Le cinquième entretien « géodynamique et métamorphisme des hautes pressions » évoque déjà ces questions. Pour l’explication détaillée, on se reportera utilement à l’ouvrage de J.Kornprobst, métamorphisme et roches métamorphiques, signification géodynamique (DUNOD), et aux articles référencés dans cet ouvrage.
Nous résumons ci-dessous les conclusions des auteurs référencés :
- a) un biseau continental s’insère dans la subduction à la suite de la croûte océanique, en noir sur la figure 35, déjà commentée dans le cinquième entretien (planche 23 bis). Son épaississement croissant se fait par empilement d’écailles les unes sur les autres : ce sont les bandes parallèles de terrains métamorphiques, dont la disposition est si frappante sur la carte géologique ; c’est la remarque préliminaire du §1 d’introduction.
- b) L’empilage des écailles de la croûte continentale aboutit au ralentissement de sa plongée, au blocage de l’enfouissement et à son réchauffement par conduction à partir de la radioactivité interne, produisant un gradient prograde typique du modèle dalradien.
- c) Les unités de la croûte océanique, qui ont subi un enfouissement précoce et de hautes pressions, sont également celles qui subissent une exhumation tectonique rapide, par poussée d’Archimède, avec son cortège de réactions rétrogrades, décrites dans le cinquième entretien. |
|
| |
Figure 35 |
Il reste à donner une réponse à l’« énigme » posée dans l’introduction sur la présence de métabasites à faciès d’éclogites, au sein des métapélites des gneiss gris z2, au Nord de Tulle.
La réponse est d’ordre mécanique, et elle est particulièrement éloquente sur le terrain, quand on compare les structures et les textures très différentes de ces deux types de roches. Nous reproduisons ici l’explication donnée dans l’ouvrage de J.Kornprobst, (opus cité).
« Cette préservation métastable des assemblages de haute pression dans les métabasites indique que l'ensemble des unités qui les contiennent — métapélites comprises — ont initialement recristallisé dans les conditions de HP. La diversité du comportement rétrograde est due à l'hétérogénéité de la déformation postéclogitique : les métapélites plastiques ont été déformées intimement; elles ont recristallisé totalement, ou presque totalement (il existe en effet des reliques de HP dans certaines d'entre elles), dans les conditions de basse pression.
Les métabasites éclogitisées, beaucoup plus rigides, faiblement ou non déformées au cœur des affleurements, n'ont subi que des recristallisations statiques peu efficaces …Ces recristallisation ont ainsi laissé subsister des reliques de HP plus ou moins coronitisées* …ou dispersées dans une matrice symplectitique*. » |