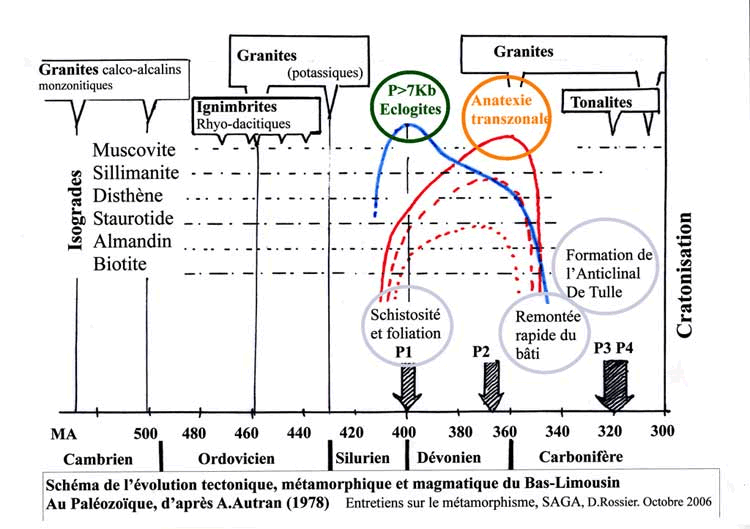L’interprétation de la carte géologique, avec la succession des bandes métamorphiques recoupées par les massifs intrusifs, nécessite d’abord de connaître la chronologie des événements ayant conduit à ces formations. Là où la stratification n’est d’aucun secours, les méthodes radioactives de datation apportent les données quantitatives indispensables, et permettent au moins de placer les événements sur une échelle temporelle absolue.
Historiquement, les méthodes géochronologiques ont été appliquées dès les années 60 aux séries cristallophylliennes du Massif Central. Mais leur véritable essor date des années 70, avec les travaux des chercheurs de l’université de Clermont, et leurs thèses (voir bibliographie).
Deux méthodes ont été conjointement mises en œuvre pour dater les terrains métamorphiques aussi bien que intrusifs :
- la méthode Rb-Sr, dite rubidium-strontium, pour les feldspaths et la muscovite.
- la méthode K-Ar , dite potassium-argon, pour les amphiboles
On remarquera que les méthodes se complètent puisque la première permet de dater les formations acides, et la seconde les formations plutôt basiques. On se reportera aux thèses et aux articles cités dans la référence (voir bibliographie).
Ce qui nous intéresse ici c’est la synthèse qui a pu en être tirée en termes de chronologie.
Tout d’abord on peut présenter par des histogrammes, attachés à chaque type de formation, les mesures K-Ar disposées les unes par rapport aux autres sur l’échelle des temps, comme le montre la figure 33. Les tonalites ont un histogramme nettement et étroitement centré sur une durée de 10 millions d’années au Namurien, dans la seconde moitié du Carbonifère. Elles sont contemporaines de la fin du cycle hercynien. Elles surgissent beaucoup plus tard que les amphibolites, apparues tout le long de la fin du Dévonien et du début du Carbonifère.
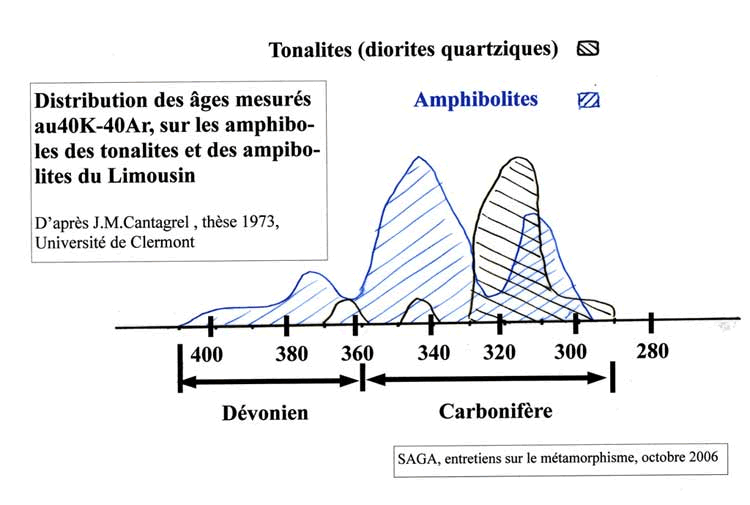 Figure 33 : Elle a été établie à partir des histogrammes de la thèse de Jean-Marie Cantagrel (1973). Elle regroupe les mesures des âges K-Ar des amphiboles prélevées dans le Limousin sur des tonalites d’une part, sur des amphibolites d’autre part.. Figure 33 : Elle a été établie à partir des histogrammes de la thèse de Jean-Marie Cantagrel (1973). Elle regroupe les mesures des âges K-Ar des amphiboles prélevées dans le Limousin sur des tonalites d’une part, sur des amphibolites d’autre part..
Une seconde présentation, beaucoup plus synthétique et regroupant les résultats de toutes les mesures, K-Ar et Rb-Sr, peut être faite en repérant les âges des différentes formations par rapport à toute la durée du Paléozoïque, et aussi aux événements tectoniques successifs
précédant, puis accompagnant, le cycle hercynien : figure 34. Cette synthèse a été faite dès 1978 (2), par A.Autran, en regroupant et recoupant les datations avec les données tectoniques, métamorphiques et magmatiques des formations du Bas-Limousin.
Les roches les plus anciennes sont les ortho-gneiss dérivés de granites monzonitiques du §3.2 : elles datent du Cambrien. Puis les méta-sédiments des formations de l’ouest de l’anticlinal, décrites au §3.1.2, ont été déposés par les événements volcaniques qui se sont produits tout le long de l’Ordovicien.
Il faut attendre le passage du Silurien au Dévonien pour voir apparaître le premier épisode métamorphique, qui est aussi celui de forte pression : c’est de cet épisode que date la formation du faciès des éclogites décrites dans le cinquième entretien. Cet épisode correspond à la phase dite P1, qui a créé partout dans le Bas-Limousin la foliation ou la schistosité de flux des roches métamorphiques. L’existence de ce faciès, en contradiction avec un schéma dalradien simpliste, va être la clé de l’interprétation géodynamique exposée au §5.
Le cycle métamorphique se poursuit pendant toute la phase P2, au Dévonien. Au début du Carbonifère, il s’achève par une anatexie intense, dans un régime de faible pression du fait de la rapide remontée du bâti (cercle gris dans les événements tectoniques de la synthèse de la figure 34). L’anatexie est responsable de l’apparition de nombreuses migmatites, dans la zone délimitée sur la carte de la figure 3 ; voir aussi le sixième entretien sur l’anatexie et les migmatites.
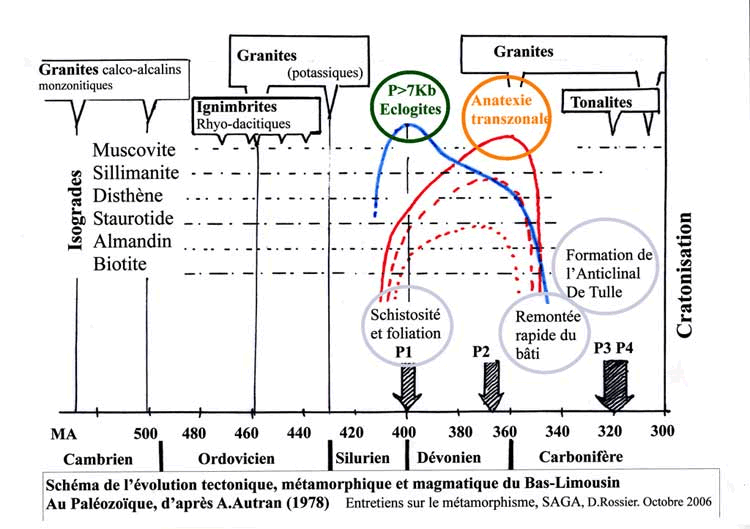
Figure 34 : Ce schéma synthétique permet de visualiser sur la même échelle de l’ère Paléozoïque les relations entre plusieurs types d’événements :
- en haut, dans les encadrés, la formation des roches d’origine, sédimentaires ou magmatiques,
- les événements métamorphiques. La variation de l’intensité du métamorphisme entre le Silurien et la fin du Dévonien est indiquée par les courbes, en bleu pour le Bas-Limousin, et en rouge pour d’autres régions du Massif Central. La courte phase précoce de haute pression (éclogites), au tout début du Silurien, est figurée dans le cercle de couleur verte. La phase finale d’anatexie transzonale est placée dans le cercle orange, elle est contemporaine de l’intrusion du granite au cœur de l’anticlinal.
- en bas du schéma, dans les cercles gris, les phases tectoniques, de P1 à P4, telles qu’elles peuvent être observées sur le terrain. |
L’intrusion des tonalites, comme l’ont montré les datations, n’est intervenue qu’après la fin du long épisode métamorphique, lors du soulévement du massif pour former l’anticlinal. Enfin, le Carbonifère finissant a scellé, cratonisé, l’ensemble des structures ainsi formées.
|
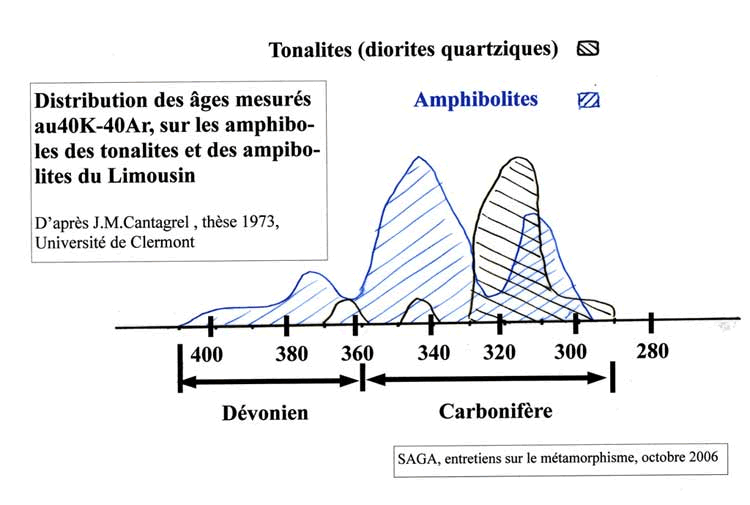 Figure 33 : Elle a été établie à partir des histogrammes de la thèse de Jean-Marie Cantagrel (1973). Elle regroupe les mesures des âges K-Ar des amphiboles prélevées dans le Limousin sur des tonalites d’une part, sur des amphibolites d’autre part..
Figure 33 : Elle a été établie à partir des histogrammes de la thèse de Jean-Marie Cantagrel (1973). Elle regroupe les mesures des âges K-Ar des amphiboles prélevées dans le Limousin sur des tonalites d’une part, sur des amphibolites d’autre part..